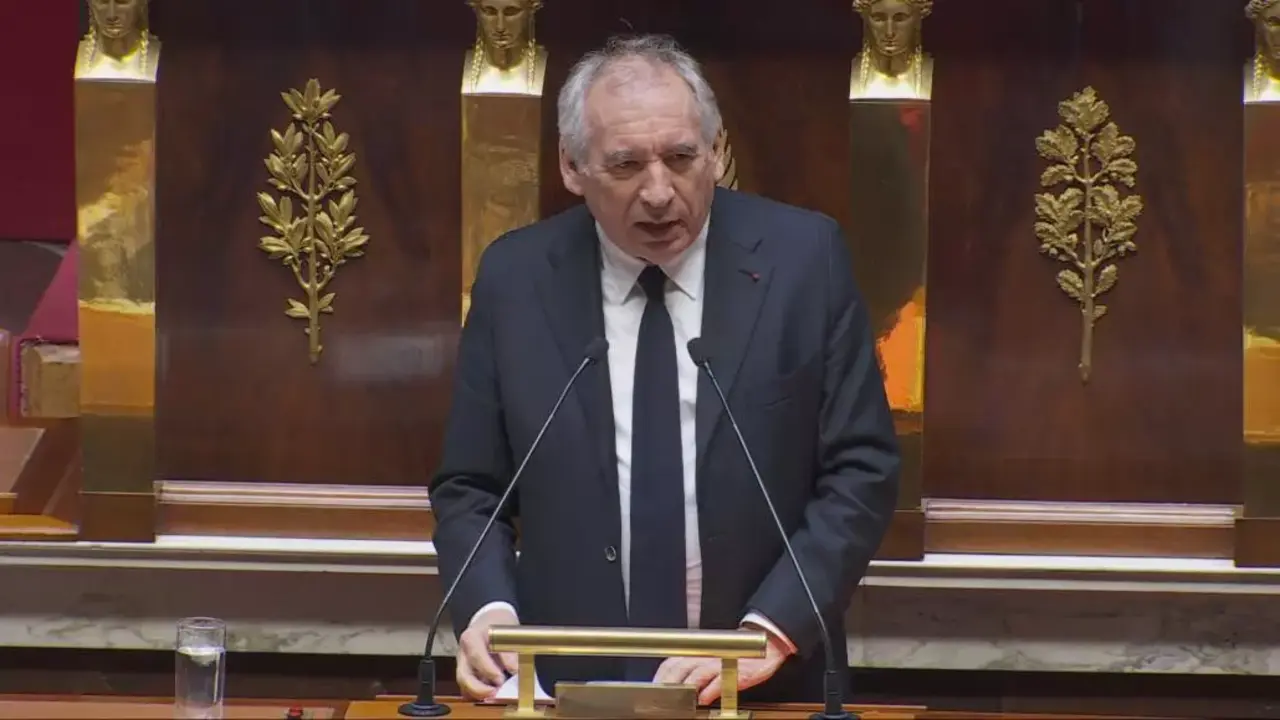Le Budget Base Zéro (BBZ) : Révolution ou Utopie Budgétaire ?
- Economie
- Finances


Face à des finances publiques sous tension et une quête perpétuelle d’efficacité, une méthode budgétaire ancienne refait surface dans le débat public et au sein des entreprises : le Budget Base Zéro (BBZ).
Popularisée dans les années 1970, cette approche radicale propose de remettre les compteurs à zéro à chaque exercice budgétaire, obligeant à justifier la moindre dépense.
Alors que le gouvernement français envisage de s’en inspirer pour maîtriser les déficits du pays, et que de nombreuses multinationales l’ont adoptée avec des fortunes diverses, il convient de s’interroger : qu’est-ce que le BBZ exactement ? Comment fonctionne cette technique ? Où a-t-elle fait ses preuves et quels en sont les écueils ? Et surtout, est-elle applicable à la complexité du budget de l’État français ?
1. Qu’est-ce qu’un Budget Base Zéro (BBZ) ?
Le Budget Base Zéro (BBZ), ou Zero-Based Budgeting (ZBB) en anglais, est une technique budgétaire et un outil de prise de décision qui se distingue fondamentalement des approches traditionnelles. Son principe fondateur est simple mais exigeant : au lieu de reconduire tacitement les budgets de l’année précédente en y appliquant des ajustements marginaux (approche dite “incrémentale”), le BBZ impose de repartir d’une “base zéro” pour chaque nouvelle période budgétaire [1].
Concrètement, cela signifie que chaque dépense, qu’elle soit nouvelle ou ancienne, doit être réévaluée, analysée et justifiée ab initio. Chaque responsable de centre de coûts doit défendre la nécessité et l’efficacité de chaque ligne budgétaire demandée, comme si elle était proposée pour la première fois. L’allocation des ressources ne se base plus sur l’historique mais sur les besoins réels et les objectifs stratégiques définis pour la période à venir, en lien avec la valeur ajoutée attendue de chaque dépense [2, 3].
L’objectif premier du BBZ, tel qu’il fut conçu initialement par Peter Pyhrr chez Texas Instruments dans les années 1960 puis popularisé dans le secteur public américain par Jimmy Carter dans les années 1970, était d’améliorer la gestion et l’efficacité de la dépense, qu’elle soit privée ou publique [4]. En forçant une réévaluation complète, le BBZ vise à identifier et éliminer les dépenses obsolètes, inefficaces ou non alignées avec les priorités, et à allouer les ressources là où elles génèrent le plus de valeur ou répondent le mieux aux besoins identifiés [1, 5]. Il s’agit donc d’une démarche proactive de rationalisation et d’optimisation des ressources, centrée sur la performance et la justification systématique des coûts engagés.
2. Quelle est précisément la technique budgétaire BBZ ?
La mise en œuvre du Budget Base Zéro suit une méthodologie rigoureuse qui rompt avec les habitudes budgétaires traditionnelles. Plutôt qu’un simple ajustement des lignes existantes, elle implique une analyse approfondie et une justification systématique de chaque dépense envisagée. Bien que les détails puissent varier selon les organisations, les étapes clés de la technique BBZ sont généralement les suivantes :
1. Identification des “unités de décision” ou “centres de décision” : L’organisation est découpée en unités logiques pour lesquelles des budgets seront préparés. Il peut s’agir de départements, de projets, de fonctions spécifiques ou de lignes de produits. Chaque unité est gérée par un responsable qui devra justifier son budget.
2. Définition des “paquets de décision” (Decision Packages) : C’est le cœur de la méthode BBZ. Pour chaque unité de décision, le responsable doit préparer des “paquets de décision”. Chaque paquet décrit une activité ou une fonction spécifique, analyse différentes manières de la réaliser (y compris l’externalisation ou l’arrêt pur et simple), évalue les coûts et les bénéfices associés, et propose différents niveaux de service ou de performance avec les ressources correspondantes [1, 6]. Typiquement, on demande au moins deux niveaux : un niveau minimal (le strict nécessaire pour maintenir l’activité) et un niveau supérieur (permettant d’atteindre des objectifs plus ambitieux). Cette décomposition permet d’identifier clairement ce qui est essentiel et ce qui relève de l’amélioration ou du développement.
3. Évaluation et classement des paquets de décision : Une fois les paquets préparés par tous les responsables, ils sont évalués et classés par ordre de priorité au niveau supérieur de l’organisation (direction, comité budgétaire). Ce classement se fait sur la base de critères prédéfinis, alignés sur les objectifs stratégiques globaux de l’entreprise ou de l’administration. L’objectif est de déterminer quels paquets de décision offrent le meilleur retour sur investissement (ROI) ou la plus grande contribution à la valeur ajoutée, compte tenu des ressources disponibles [2]. Ce processus peut être complexe et nécessite des critères objectifs pour éviter les biais et les luttes d’influence internes [3].
4. Allocation des ressources et élaboration du budget final : En fonction du classement des paquets de décision et de l’enveloppe budgétaire globale disponible, la direction décide quels paquets seront financés. Les paquets les mieux classés sont approuvés jusqu’à épuisement des fonds disponibles. Les paquets non financés correspondent aux activités qui ne seront pas entreprises ou qui seront réalisées à un niveau de service inférieur. Le budget final est ainsi constitué de l’ensemble des paquets de décision approuvés [1, 6].
Cette approche granulaire et analytique force les gestionnaires à comprendre en profondeur les coûts et les bénéfices de chaque activité. Elle favorise une allocation des ressources plus rationnelle, basée sur la performance et la pertinence stratégique plutôt que sur l’inertie historique. Elle pousse également à l’innovation en encourageant la recherche d’alternatives plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés [1, 3]. Cependant, comme nous le verrons, cette méthode est exigeante en temps et en ressources pour sa mise en œuvre.
3. Où le BBZ a-t-il déjà été utilisé avec succès (et moins de succès) ?
Le Budget Base Zéro n’est pas une nouveauté et a été expérimenté à de multiples reprises, tant dans le secteur privé que public, avec des résultats variés. Son application rigoureuse peut générer des économies substantielles et améliorer l’efficacité, mais une mise en œuvre trop brutale ou mal ciblée peut aussi avoir des effets délétères.
Succès dans le secteur privé (avec nuances) :
Unilever : Souvent cité comme un exemple positif, le géant des biens de consommation a adopté le BBZ en 2017. Loin d’une coupe aveugle, l’approche visait à réallouer plus intelligemment les ressources, notamment marketing. En forçant chaque équipe à justifier ses dépenses en fonction du retour sur investissement attendu, Unilever a pu augmenter sa marge opérationnelle en réalisant des gains d’efficacité, tout en augmentant même les dépenses absolues de marketing jugées pertinentes [7]. L’approche “marathon” d’Unilever, axée sur la discipline stratégique et le long terme, contraste avec des applications plus agressives.
Guess : Confrontée à la crise du Covid-19, l’entreprise de mode a utilisé le BBZ comme un outil de survie (“lutte ou fuite”). En réévaluant toutes ses dépenses, Guess a réussi à réduire significativement ses coûts d’exploitation et d’investissement trimestriels, lui permettant de traverser la crise tout en préservant des ressources pour la reprise [7].
Autres entreprises : Des groupes comme Coca-Cola ou Mondelez sont également cités parmi les entreprises ayant eu recours au BBZ pour rationaliser leurs coûts [4].
Un exemple controversé : Kraft Heinz
La fusion de Kraft et Heinz sous l’égide du fonds 3G Capital en 2015 est souvent présentée comme un cas d’école des dérives possibles du BBZ. L’application ultra-agressive de la méthode, visant des réductions de coûts massives et rapides (“Buy Squeeze Repeat”), a certes permis d’améliorer les marges à court terme (baisse drastique des effectifs et des frais généraux). Cependant, elle s’est faite au détriment de l’investissement dans les marques, l’innovation et l’adaptation aux nouvelles tendances de consommation. Le résultat fut une dépréciation massive de la valeur de l’entreprise et une chute spectaculaire de l’action en 2019, illustrant les risques d’une focalisation excessive sur les coûts au détriment de la croissance future [7].
Dans le secteur public :
Depuis trois ans, le Département de la Seine-Maritime, en Normandie, utilise la méthode du « budget base zéro » (BBZ) pour établir son budget. Cette approche consiste à ne pas reconduire le budget de l’année précédente, mais à repartir de zéro en réévaluant chaque année les objectifs et les dépenses. Bertrand Bellanger, président du Département (centre-droit), est un fervent défenseur de cette méthode.
États-Unis (années 1970) : Jimmy Carter, d’abord comme gouverneur de Géorgie puis comme Président, a tenté d’implémenter le BBZ au niveau fédéral. L’objectif était de lutter contre l’inefficacité et le gaspillage en réexaminant tous les programmes gouvernementaux. Si l’initiative a eu un certain écho, sa mise en œuvre à grande échelle s’est heurtée à d’énormes difficultés pratiques et politiques, notamment la lourdeur du processus et la résistance des administrations [1, 4]. L’expérience a montré la complexité d’appliquer une telle méthode à la totalité d’un budget public.
Initiatives plus récentes : Des entités publiques, comme la Région Wallonne en Belgique, ont également exploré ou mis en œuvre des approches inspirées du BBZ, souvent dans le cadre de revues de dépenses ciblées plutôt qu’une application généralisée [8].
Ces exemples montrent que le succès du BBZ dépend fortement du contexte, des objectifs visés (réduction drastique vs. réallocation stratégique) et de la manière dont il est mis en œuvre (progressif vs. brutal). Il ne s’agit pas d’une solution miracle, mais d’un outil puissant qui doit être manié avec discernement.
4. Comment appliquer la méthode BBZ au budget de la France ?
L’idée d’appliquer une logique de Budget Base Zéro aux finances publiques françaises n’est pas nouvelle, mais elle a regagné en vigueur récemment dans un contexte de déficits élevés et de recherche d’économies structurelles. Le gouvernement actuel a explicitement mentionné son intention de s’inspirer de cette méthode pour la préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2026 [4, 9].
L’intention affichée :
Selon les communications officielles, notamment de la Direction du Budget, la préparation du PLF 2026 doit s’inscrire dans un effort de rationalisation où “chaque dépense publique sera réinterrogée sur son utilité, son efficacité” [9]. Les ministères sont invités à réfléchir à leur budget selon une “logique de budget base zéro”, impliquant une repriorisation des missions, l’extinction des dépenses de crise non justifiées, et la recherche de réformes structurelles. L’objectif est de rompre avec l’inertie et les reconductions automatiques, pour s’assurer que chaque euro dépensé correspond à une priorité politique claire et contribue efficacement à la croissance ou aux missions essentielles de l’État [4].
Le Budget Base Zéro est bien plus qu’une simple technique comptable ; c’est une philosophie de gestion qui force à une introspection profonde sur la pertinence et l’efficacité de chaque dépense. Son potentiel de rationalisation et d’alignement stratégique est indéniable, comme en témoignent certains succès dans le secteur privé lorsqu’il est appliqué avec discernement et vision à long terme. Cependant, les exemples d’échecs ou de dérives, notamment le cas Kraft Heinz, rappellent que le BBZ n’est pas une panacée et qu’une application trop brutale, focalisée uniquement sur la réduction des coûts à court terme, peut s’avérer destructrice.
L’application de cette logique au budget de l’État français représente un défi d’une tout autre ampleur. Si l’ambition de réinterroger l’utilité de chaque dépense publique est légitime dans un contexte de maîtrise budgétaire, la complexité de l’action publique, la rigidité de certaines dépenses et les enjeux politiques rendent une application intégrale et annuelle du BBZ peu réaliste. L’approche française s’orientera vraisemblablement vers une méthode hybride, combinant des revues de dépenses ciblées et une culture renforcée de l’évaluation, plutôt qu’une remise à zéro généralisée.
En définitive, le BBZ est un outil puissant mais exigeant. Son succès dépendra de la capacité des décideurs, publics comme privés, à l’adapter intelligemment à leur contexte, à définir des objectifs clairs (au-delà de la simple coupe budgétaire) et à accompagner le changement culturel qu’il implique. Utilisé avec pragmatisme et vision stratégique, il peut contribuer à une allocation plus efficace des ressources ; manié sans discernement, il risque de n’être qu’un instrument de coupes douloureuses aux bénéfices éphémères.
Sources :
[1] Budget base zéro
[2] La technique budgétaire BBZ ou Budget Base Zéro – OMS.
[3] Budget base zéro : Définition, caractéristiques et avantages
[4] Qu’est-ce que cette méthode “BBZ” en vogue dans les entreprises américaines dont le gouvernement veut s’inspirer pour faire des économies ?
[5] Qu’est-ce que la budgétisation base zéro : un guide complet
[6] La méthode du BBZ : Le zero based budgeting ou en français le budget base zéro
[7] Des coupes sombres aux gains stratégiques : 3 exemples de budget base zéro
[8] Un budget base zéro pour la Wallonie : du neuf avec du vieux
[9] Nouvelle étape de la construction du PLF 2026 : les conférences budgétaires